Pasado Abierto. Revista del CEHis. Nº2. Mar del Plata. Julio-Diciembre 2015.
ISSN Nº2451-6961.
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
Jusqu’a quel point les regimes politiques façonnent-ils l’organisation des partis politiques? L’exemple de la france contemporaine
Frédéric Sawicki
Université Paris 1-Pantheón Sorbonne, Francia
frederic.sawicki@univ-paris1.fr
Florence Haegel
Sciences Po, Paris, Francia
florence.haegel@sciencespo.fr
Recibido:25/10/2015
Aceptado: 08/12/2015
Resumen
Este artículo se interroga acerca del impacto que tuvieron las reglas institucionales sobre la organización de los partidos políticos para el caso de Francia. Compara los efectos de la presidencialización sobre los dos principales partidos franceses, el Partido Socialista y el UMP (ex Unión por un Movimiento Popular) /Los Republicanos. En contra de un institucionalismo clásico que consideraba que esos partidos se habrían adaptado de manera pasiva, automática y unívoca a la restricción, aquí se defiende la idea de que estos partidos están atravesados por dinámicas contradictorias que refieren tanto a la lógica presidencial como parlamentaria y local. También se demuestra que esta adaptación fue compleja, indirecta y largo tiempo demorada en la medida en que ella respondió principalmente a las lógicas internas de los partidos y a lógicas de mimetismo.
Palabras claves: partidos políticos; régimen político; presidencialismo; Francia; Vº República
To what extent do political regimes shape party organizations? The French case
Abstract
This article addresses the question of the impact of institutional rules on party organizations focusing on French case. It compares the impact of presidentialization on two major French parties, the PS and the UMP/ Les Républicains. Against classical institutionalism assuming that parties accommodate presidential constraint in a passive, automatic and unequivocal way, it argues that parties deal with contradictory dynamics based on both presidential and parliamentarian and local incentives. It also shows that this accommodation is complex, occurred indirectly and has been postponed for a long while in so far as it mainly addressed party internal issues and met mimetic drives.
Keywords: political parties; political regime; presidentialism; France; Fifth Republic
Jusqu’a quel point les regimes politiques façonnent-ils l’organisation des partis politiques? L’exemple de la france contemporaine
La question que pose cet article peut paraître naïve. Pour de nombreux spécialistes des partis politiques, il paraît acquis que les caractéristiques d’un régime politique (non seulement sa constitution, mais l’agencement singulier de ses institutions, les règles et les habitudes politiques en vigueur[1] influencent largement la façon dont les partis sont organisés. Nombre d’auteurs ont ainsi souligné, à propos des Etats-Unis, combien la structure fédérale du pays, l’existence d’un président élu au suffrage universel non responsable devant le Congrès, le mode de scrutin exclusivement majoritaire à un tour pour toutes les élections qui a entraîné l’apparition des élections primaires, ont contribué à façonner des partis souples, décentralisés[2] et “attrape-tout” (Kirchheimer, 1966: 177-200) (catch-all). On pourrait ajouter que la grande latitude laissée en pratique aux entreprises et aux donateurs privés de financer les activités politiques, combiné aux élections primaires, a amplifié le caractère très informel des partis américains et favorisé une politique centrée sur les candidats (Wattenberg, 1991). À l’inverse, en GrandeBretagne, la combinaison du parlementarisme et du caractère unitaire et centralisé de l’État passent pour avoir favorisé la formation de partis disciplinés et idéologiques[3] .
Bien sûr, il faut se garder de trop exagérer la convergence entre les partis au sein d’un même système de partis, chacun d’entre eux ayant son histoire propre. Il ne faut pas non plus minimiser les changements sociologiques et économiques de toutes sortes qui affectent l’organisation des partis politiques tout autant que les facteurs institutionnels. On peut néanmoins faire l’hypothèse que la relation entre régime politique et forme d’organisation des partis est d’autant plus forte que les régimes sont anciens et stables et que par conséquent les stratégies des partis politiques pour changer les règles en leur faveur ont très peu de chances de réussir. Dans ces conditions les partis n’ont comme seule alternative que de s’adapter sauf à disparaître.
Or de nombreux régimes politiques ne connaissent pas la même stabilité institutionnelle que les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne. Ainsi la France se distinguet-elle, parmi les “veilles” démocraties, par une instabilité des règles du jeu politique assez exceptionnelle, tant sur le long terme[4] , que sur le moyen terme. La Ve République a beau être considérée comme stable depuis 1958, les changements constitutionnels et, plus largement, la transformation des règles qui encadrent la vie politique (les modes de scrutin, la législation sur le financement des activités politiques, les possibilités de cumuler plusieurs mandats en même temps, la répartition des compétences entre les pouvoirs locaux et le pouvoir national) ont été incessants. Parmi les plus importants, on peut citer l’adoption par référendum, en 1962, du principe de l’élection du président de la République au suffrage universel ; la mise en place, à partir de 1982, d’un vaste mouvement de décentralisation ayant démultiplié les échelons de compétence (communes, intercommunalités, département, région) et renforcé le pouvoir des élus locaux ; l’introduction, à partir de 1988, du financement public des partis politiques qui a débouché sur l’interdiction en 1995 du financement des partis par les entreprises ; et enfin, en 2000, l’alignement de la durée du mandat du président, ramené à cinq ans (au lieu de sept) sur celui des députés suivi par le vote d’une loi ordinaire faisant intervenir l’élection présidentielle après les élections législatives. Mais plus encore, ce qui singularise la démocratie française, est que la question de la bonne forme des institutions politiques continue d’y faire débat et que chaque parti et chaque candidat à l’élection présidentielle a toujours dans son programme un projet de réforme de la constitution!
Cette absence de consensus sur les règles du jeu politique s’explique en partie par le caractère hybride du régime, mi-présidentiel, mi-parlementaire[5] . Le président de la République, élu depuis 1962 au suffrage universel pour 7 ans jusqu’en 2002, nomme le premier ministre, peut dissoudre la chambre basse (l’Assemblée nationale) mais celle-ci ne peut en retour le contraindre à démissionner. Aussi, quand les majorités présidentielle et parlementaire coïncident, les députés apparaissent largement soumis au programme et aux décisions du président et le premier ministre apparaît comme un simple exécutant puisque le président peut le remplacer à sa guise[6] . Quand les majorités ne coïncident pas, comme ce fut le cas entre 1986 et 1988, 1993 et 1995 et entre 1997 et 2002, le parlement reprend ses droits et le premier ministre devient le véritable chef de l’exécutif et cohabite difficilement avec le président qui se replie alors sur ses prérogatives diplomatiques et militaires.
C’est précisément pour éviter cette situation que les chefs des deux principaux partis français (Jacques Chirac pour la droite gaulliste, Lionel Jospin pour le parti socialiste) ont décidé de soutenir la réforme constitutionnelle précédemment évoquée qui a abouti à aligner le mandat du président sur celui des députés. La présidentialisation des institutions s’en est depuis trouvée renforcée et les parlementaires plus que jamais soumis au président. On comprend dès lors pourquoi le rééquilibrage des pouvoirs en faveur du parlement et du premier ministre, mais aussi la question du droit de l’opposition et des minorités mal ou non représentées (par le biais notamment de l’introduction d’une part de proportionnelle dans le mode de scrutin) constituent autant d’enjeux saillants du débat politique en France. La question du rééquilibrage des pouvoirs du président de la République au profit du premier ministre et du parlement et la question de la réforme du mode de scrutin sont ainsi régulièrement inscrites à l’agenda politique, tout particulièrement par les partis de gauche et du centre. Cette instabilité relative et ce désaccord sur les règles du jeu politique expliquent d’une part que les partis français sont soumis à des changements fréquents de leur environnement, mais aussi qu’ils peuvent privilégier une stratégie de modification des règles du jeu politique (en leur faveur) plutôt qu’une stratégie d’adaptation.
En dépit de cette constatation l’idée que les partis français seraient surdéterminés par la centralité de l’élection présidentielle et que leur organisation aurait fini par se calquer sur le modèle présidentiel est défendue par de nombreux spécialistes[7] . Les tenants de cette thèse ont pu récemment en voir une confirmation dans la généralisation de l’adoption d’élections primaires ouvertes pour désigner le candidat par les deux principaux partis français: le parti socialiste d’abord en 2012, puis l’UMP (devenu en 2015 Les Républicains) en 2014[8] . Les partis français seraient donc désormais devenus des fédérations mouvantes d’équipes constituées autour de candidats potentiels à l’élection présidentielle et auraient été conduits à sous-traiter le choix de leur leader aux électeurs pour éviter d’imploser. En conséquence, ils auraient perdu leur vocation à l’élaborer des programmes et leurs militants seraient désormais des supporters ou des clients.
Ce type d’approche, qui s’apparente à l’institutionnalisme classique, considère les partis politiques comme des sujets plutôt que des acteurs. Ils apparaissent comme subissant des règles politiques et non comme les co-produisant ; leurs spécificités, héritées de leur histoire propre, semblent n’avoir qu’un faible impact sur la façon dont ils s’organisent. C’est ce présupposé, que l'on retrouve dans nombre d’études sur la présidentialisation des partis, que nous voudrions discuter ici en nous focalisant plus particulièrement sur les cas du Parti socialiste et des partis néo-gaullistes (le Rassemblement pour la République – RPR – puis l’Union pour un mouvement populaire – UMP – [9] ), nos deux terrains de prédilection.
Il ne s’agit bien sûr pas ici de nier l’impact de centralité de l’élection présidentielle sur l’organisation et les pratiques des partis politiques mais simplement de compléter et nuancer le tableau. Nous rappellerons en premier lieu que la centralité du trophée présidentiel demeure contrebalancée par celle d’autres trophées (les mandats parlementaires et les mandats locaux) tout aussi cruciaux pour un nombre non négligeable, voire croissant, des membres et dirigeants des partis dits “de gouvernement”. Entre logiques présidentielle, parlementaire et locale, ces partis sont bien traversés par des impératifs divers qui interfèrent en permanence dans leurs stratégies et modèlent leur organisation. La centralisation du parti autour du leader apparaît ici très largement contrebalancée par la très forte autonomie des échelons locaux du parti et la capacité des grands élus locaux à négocier leur soutien à leur leader en fonction de leurs intérêts propres. De ce point de vue, la décentralisation a autant sinon plus d’impact sur l’organisation des partis français que la présidentialisation de la compétition politique nationale. Les partis sont donc bien influencés par les institutions, mais ils ne le sont pas de façon univoque et passive.
Nous mettrons ensuite à l'épreuve la notion même d'adaptation qui suggère une conformation à un modèle ou à une règle extérieure et qui postule un mouvement à la fois trop univoque, trop automatique et trop vertical. Nous verrons ainsi que tant la mise en place de mécanismes de désignation directe des chefs de parti par les adhérents au cours des décennies 1980 et 1990, que l’introduction de primaires ouvertes aux sympathisants (amorcée par le PS en 2006 par la création d’un statut d’adhérent-électeur à bas coût (20 euros) avant d’être élargie à tous les électeurs en 2011, décidée en 2013 pour être appliquée en 2016 pour l’UMP) pour désigner leur candidat à l’élection présidentielle – près d’un demi-siècle après l’entrée en vigueur de l’élection du président de la République au suffrage universel ! –, ne sauraient être lues comme une simple adaptation fonctionnelle à une Cinquième République présidentialo-centrée. La “démocratisation” de la désignation des candidats à l’élection présidentielle doit être rapportée à des moments d'incertitude ou de déstabilisation et aux luttes partisanes internes non entièrement réductibles aux stratégies des candidats à l’élection présidentielle.
La force renouvelée de la contrainte parlementaire
Personne ne peut prétendre que la recherche du trophée présidentiel ne s'est pas imposée dans le jeu politique français. L'élection présidentielle structure aujourd'hui le tempo de la vie politique française et détermine la hiérarchie des objectifs d'un certain nombre d'acteurs politiques: quelques-uns tentent de se forger un statut de présidentiable; beaucoup cherchent surtout à ménager le soutien qu'ils apporteront à un candidat, ce soutien dépendant à la fois de proximités politiques et personnelles, des marchandages et des pronostics alimentés par les sondages de popularité. Toutefois, quel que soit l'impact de la présidentialisation, elle n'a pas balayé les autres contraintes qui pèsent sur les partis politiques, au premier rang desquelles les contraintes parlementaires et locales.
Régime “semi-présidentiel”, “hybride”, la Cinquième République est, depuis son origine, marquée par une logique parlementaire que le renforcement de la contrainte présidentielle n'a jamais vraiment effacée. L'importance des élections législatives dans l'économie générale des partis politiques s'est même accentuée avec l'adoption entre 1988 et 2003 de cinq lois de financement des partis politiques qui ont toutes affirmé le rôle central des élections législatives dans l’attribution de la dotation publique aux partis politiques (70 millions d’euros en 2013). Cette dotation se décompose en deux parts à peu près égales. La première est fonction du résultat du parti au premier tour des élections législatives. Pour y prétendre un parti doit recueillir 1% des voix dans au minimum 50 circonscriptions. La seconde moitié est fonction du nombre de sièges de députés gagné par chaque parti. Pour les deux partis dont il est ici question, les fluctuations électorales aux législatives se traduisent donc directement en gains ou pertes financières importants. Ainsi, la défaite de l’UMP aux élections législatives de juin 2012 et le non respect du principe de parité ont amputé son budget de 40% de sa dotation, mettant le parti dans une situation financière périlleuse, dans un contexte où la contrainte financière est de plus en plus pressante pour des partis dont les effectifs stagnent ou baissent et qui doivent faire face à la croissance des dépenses de communication, d’événementiel ou de marketing dans leur budget.
Disposer de candidats solidement implantés localement est donc une nécessité vitale pour les partis, tout comme est essentiel pour eux la garantie, qu’une fois élus, les députés qu’ils ont soutenu se déclarent bel et bien affiliés au parti pour leur faire bénéficier du montant de la dotation correspondant. Compte tenu du mode de scrutin, personnel et territorialisé (scrutin majoritaire à deux tours), les partis français sont donc plus que jamais conduits à favoriser des candidats disposant d’une solide assise locale, c’est-à-dire souvent déjà élus précédemment comme maire, conseiller général ou conseiller régional. Cette situation explique que les échelons locaux des partis politiques français disposent souvent d’une grande autonomie et que les risques de candidatures dissidentes, dans les cas où un candidat bien implanté dans sa circonscription n’a pas reçu l’investiture du parti, sont importants. Ces risques sont accrus en raison du fait que les deux principaux partis français doivent s’allier avec des partis plus petits pour conquérir la majorité : le parti écologiste et le parti radical de gauche pour le PS ; un parti centriste (l’UDI, l’Union des démocrates et indépendants) pour l’UMP. Les directions des deux grands partis français négocient ainsi avec leurs alliés la répartition des circonscriptions, au risque de voir leurs choix contestés localement.
On a parfois interprété la constitution d’un parti unique de la droite et d’une partie du centre en 2002 comme la conséquence de la large victoire de Jacques Chirac à l’élection présidentielle[10]. Or, comme l’a montré Florence Haegel, cette fusion des partis de droite obéit d’abord aux objectifs des parlementaires et des dirigeants du parti. Cette fusion est un moyen de régler les “tensions qui résultent de la disjonction des dispositifs de coopération législative et présidentielle” (Haegel, 2012: 79). Depuis l’émergence, au milieu des années 1980, du Front national, les partis qui composent la droite et le centre ont été contraints de renforcer leur coopération et de négocier a priori la répartition des candidatures émanant de leurs différentes sensibilités à toutes les élections, au risque de se diviser et de favoriser l’élection d’un de leurs adversaires. On a donc assisté à un renforcement des procédures de coopération, sauf pour l’élection présidentielle où la répartition des sièges n’est évidemment pas possible.
Cette situation a conféré un rôle central aux partis qui en plus de gérer le partage des circonscriptions fondé sur le principe de la prime au sortant, ont été conduits à élaborer un socle programmatique commun pour justifier ces alliances. Cette situation a rapproché les militants et les élus des différents partis. L’absence de régulation de la compétition pour l’élection présidentielle où il était de coutume que les candidats représentant les différentes tendances de la droite s’affrontent au premier tour, est apparue de plus en plus comme entrant en contradiction avec ce rapprochement. L’affrontement non régulé pour l’élection présidentielle fait non seulement courir à la droite le risque de se retrouver sans candidat au second tour, mais exacerbe les tensions et affaiblit les partis par les “trahisons” qu’il favorise. Au cours des années 1980-1990 deux “solutions” concurrentes pour régler ces tensions sont dès lors imaginées : “la première prenant comme levier institutionnel l’élection présidentielle et s’incarnant dans un projet de primaires, la seconde s’appuyant sur le dispositif législatif et revêtant une forme confédérative” (2012: 95). La victoire de J. Chirac et la nécessité de renouer la confiance avec les parlementaires après la cinglante défaite aux législatives de 1997 vont favoriser l’adoption de la seconde solution. L’unification de la droite n’a donc été possible que parce qu’elle correspondait à l’attente de nombreux dirigeants, élus, militants et responsables locaux qui souffraient des effets délétères de la compétition présidentielle, dans un contexte politique marqué par la montée en puissance du Front national avec lequel toute alliance apparaît impossible.
En ce qui concerne le PS, qui est dans une position moins hégémonique à gauche que l’UMP à droite, la négociation des investitures législatives apparaît comme un enjeu tout aussi délicat et essentiel que le choix du candidat à l’élection présidentielle. Si la stratégie face au parti communiste est largement stabilisée (compétition au premier tour, désistement pour le candidat arrivé en tête au second), les accords de gouvernement passés avec les Verts et les radicaux de gauche contraignent les dirigeants du parti à réserver à la fois un nombre significatif de circonscriptions à leurs partenaires et à s’efforcer de disposer à eux seuls de la majorité la plus large possible. La concomitance des calendriers électoraux empêchant de procéder aux négociations programmatiques et aux investitures entre la présidentielle et les législatives et de faire correspondre leur répartition avec les résultats du premier tour, les négociations échappent largement au candidat investi pour l’élection présidentielle et créent une zone d’incertitude importante quant à la nature de la majorité législative en cas de victoire.
Pour l'UMP comme pour le PS, l'arène parlementaire apparaît non seulement centrale du point de vue des finances et de la latitude politique dont dispose le président élu vis-à-vis de sa majorité parlementaire, mais aussi en termes d’accès aux positions gouvernementales. À rebours des pronostics qui pouvaient être faits au début des années 1980, sur la foi de l’augmentation du nombre des ministres non élus au cours des vingt premières années de la Cinquième République, quant à l’avènement d’une nouvelle filière d’accès aux positions de leadership politique fondée sur l’excellence technocratique (Gaïti,1985: 53-85; Gaxie,1986: 61-78), le passage par le Parlement s’est non seulement maintenu, mais renforcé comme un point d’accès à la carrière ministérielle. Même si les présidents de la République peuvent nommer les ministres qu’ils veulent, ils les choisissent majoritairement parmi les parlementaires. Ainsi que l’ont montré Valentin Behr et Sébastien Michon dans leur étude des ministres et secrétaires d’État en poste entre 1986 et 2012 (Behr et Michon 2013: 332-355) 80% d’entre eux ont déjà exercé un mandat électif au moment de leur première accession au gouvernement, dont deux tiers à l’Assemblée nationale et 12% au Sénat, une proportion identique à gauche et à droite. Certes l’exercice d’un mandat parlementaire n’est déterminant, d’après leurs estimations, que pour un peu plus d’un quart des ministres, d’autres capitaux étant tout aussi essentiels pour les trois quarts des autres (passage par un cabinet ministériel, occupation de positions partisanes ou de positions locales fortes). Mais il n’en reste pas moins que même pour ces derniers, le passage par le Parlement, et singulièrement par l’Assemblée nationale, facilite l’investissement dans les activités et réseaux partisans centraux et confère une légitimité qui en fait un point de passage obligé, nécessaire sinon suffisant, à l’accès au gouvernement. On notera à cet égard qu’entre 2012 et 2014, le premier ministre socialiste (Jean-Marc Ayrault), comme le président de l'UMP (Jean-François Copé), ont tous deux occupé le poste de président du groupe parlementaire de leur parti.
Tout se passe comme si la concordance des mandats présidentiel et parlementaire depuis 2002 avait renforcé l’arène parlementaire au détriment des instances de direction des partis politiques. Durant le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, le glissement de la vie partisane vers l’arène parlementaire a été manifeste. La direction du parti étant largement verrouillée et pilotée à partir de l’Élysée, l'expression pluraliste et le débat se sont déplacés au sein d'un groupe parlementaire peuplé de plus de 300 députés. À la différence du PS où les factions (appelées “courants”) continuent de structurer verticalement (du local au national) et horizontalement (dans les instances collégiales) l’ensemble des strates du parti, l’UMP a ajourné de 2002 à 2012 la reconnaissance de courants internes. Dès lors, ceux-ci ont investi la périphérie du parti, en particulier le groupe parlementaire. C'est ainsi le groupe parlementaire qui a pesé dans le choix de maintenir le même premier ministre (François Fillon) tout au long de la durée du quinquennat et c'est aussi à partir de lui que s'est engagée la stratégie de droitisation de l'UMP. En effet, en juillet 2010 un groupe de députés crée la Droite populaire. Très actifs sur le plan parlementaire, ce groupe a promu, avant l'élection présidentielle de 2012, les thèmes marquant cette droitisation et le rapprochement avec le FN: restriction des droits des immigrés (en matière sociale et de justice), défense de la police et de l’armée et d’un ordre moral, familial, scolaire et sexuel (oppositions aux droits des homosexuels en matière de mariage et à la lutte contre l’homophobie et à la “théorie du genre”). Ainsi, il serait bien trop rapide d'imputer la droitisation de l'UMP à une simple stratégie présidentielle puisqu'une partie de l'Assemblée nationale en a aussi été le creuset. Le PS connaît un processus analogue depuis 2012. La nomination d’un homme d’appareil sans passé gouvernemental et sans expérience ni appuis parlementaires à la tête du parti (Harlem Désir), a accéléré le déplacement du centre de gravité des arènes partisanes (bureau et secrétariat nationaux) vers l’Assemblée nationale. Les parlementaires, et singulièrement dans un premier temps ceux de l’aile gauche du parti, rejoints après la débâcle électorale des municipales de mars 2014 par des proches de l’ancienne première secrétaire Martine Aubry, sont devenus le principal canal d’expression du mécontentement vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement. Abstentions, voire votes contre, à des scrutins stratégiques (Pacte de stabilité européen, Accord national interprofessionnel, loi sur les retraites, Pacte de responsabilité), prises de position publiques en faveur de réformes abandonnées, parfois sous forme de pétitions adressées au président de la République, n’ont cessé de se multiplier, au point que la création d’un groupe “dissident” est de plus en plus évoquée par certains comme une menace.
On peut ici risquer l’hypothèse qu’en poussant les présidents à investir totalement la fonction gouvernementale, le quinquennat et l’inversion du calendrier électoral ont paradoxalement renforcé le pouvoir du parlement. En liant comme jamais auparavant le sort électoral du président à celui des députés, il a conduit ces derniers à être particulièrement sensibles aux variations de la cote de popularité présidentielle et à tirer partie de toutes les marges de jeu que leur laisse la constitution. Dans cette reconfiguration des rapports entre exécutif et législatif, il est d’ailleurs loisible de se demander si la menace de la dissolution de l’Assemblée nationale a encore la moindre efficacité.
En bref, la prégnance de la logique présidentielle n'a pas fait disparaître l'impact des logiques législatives et le poids de l'arène parlementaire dans l'économie globale des partis politiques français. Cet impact a même été renforcé par l'indexation de la dotation publique sur les résultats législatifs. Si l'on considère tant les carrières politiques que les mutations idéologiques, nombreux sont les exemples attestant la place que continue d’occuper l'arène parlementaire.
L’importance des logiques locales
La grande majorité des analyses portant sur les partis comme institution et comme système se réfère principalement à la compétition politique nationale. Or pour de nombreux membres des partis dits de gouvernement et notamment pour tous ceux qui exercent ou aspirent principalement à exercer des mandats locaux, particulièrement nombreux en France compte tenu du nombre de collectivités territoriales, la conquête du trophée présidentiel ne constitue ni la seule ni même sans doute la principale préoccupation. On peut dès lors faire l’hypothèse qu’ils ne sont enclins à accepter les éventuelles transformations ou adaptations de l’organisation partisane aux logiques présidentielles (par exemple le respect partiel du programme du parti par le candidat, l’introduction éventuelle de primaires minimisant ou diluant leur rôle dans la sélection du candidat, l’enrôlement dans les équipes des “présidentiables” et la mise à leur service de leurs ressources lors des campagnes présidentielle) que tant que cela n’affaiblit pas leur(s) position(s) locale(s).
Bien sûr, la spécificité française de cumuler le mandat parlementaire avec un mandat exécutif local, combinée au très faible nombre de postes de permanents des partis politiques, au mode de scrutin qui prévaut pour les élections parlementaires et à la concordance de toutes les élections locales du même ordre au même moment, contribuent à la forte interdépendance des arènes locales et nationales. Cette interdépendance amène notamment tous ceux qui briguent des responsabilités nationales comme parlementaire, ministre, président ou dirigeant de parti à se constituer ce qu’en langage indigène on appelle un “fief ”, c’est-à-dire un stock de ressources territorialisées permettant à la fois de se prémunir contre les aléas électoraux et de viser la conquête de trophées plus prestigieux, plus rémunérateurs ou plus protecteurs. Peu nombreux sont les dirigeants nationaux de partis politiques ou les prétendants à la magistrature suprême à ne pas s’appuyer sur des bases territorialisées solides quand bien même auraient-ils commencé leur carrière en occupant des positions ministérielles. Sans les ressources fournies par la mairie de Paris ou par le Conseil général des Hauts-de-Seine (le plus riche de France), il n’est pas sûr que Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy soient parvenus à surmonter tous les revers de leur carrière et à maintenir leur position prééminente au sein de leur parti. De même, lors des primaires ouvertes de 2012 organisées par le PS, tous les candidats disposaient d’un solide ancrage territorial (municipal, départemental ou régional). L’emboîtement des arènes locales et nationales explique que les partis français n’ont pas cette forme stratarchique qui caractérise les partis aux Etats-Unis (Eldersveld, 1964) laquelle se traduit par une autonomie très large des partis locaux ou régionaux. Mais s’ils ne sont pas stratarchiques, ils apparaissent aujourd’hui particulièrement peu bureaucratisés et peu centralisés.
En augmentant le nombre et la valeur des ressources locales, la décentralisation a en effet considérablement renforcé le rôle des élus locaux au sein des partis politiques et, partant, leurs capacités à résister aux injonctions de leur parti. Les partis “locaux” semblent échapper de plus en plus au contrôle du centre, tout particulièrement à gauche où la discipline partisane est traditionnellement plus forte. Même le Parti communiste, hier très centralisé et contrôlé par un puissant corps de permanents, est désormais devenu un parti d’élus locaux qui ont des stratégies politiques et mènent des politiques qui varient beaucoup selon les contextes politiques locaux et qui rendent de moins en moins de compte à la direction de leur parti[11]. Le Parti socialiste, qui a toujours laissé un rôle plus important aux adhérents dans l’investiture des candidats, a vu ces dernières années se multiplier les conflits entre la direction nationale et les dirigeants de ses plus grandes fédérations (Hérault, Bouches-du-Rhône, Pas-de-Calais), révélant les faibles marges de manœuvre à sa disposition pour sanctionner les pratiques et discours déviants ou dissidents[12]. Plus largement à gauche, les alliances passées lors des élections locales échappent de plus en plus à un strict cadrage national : les alliances sont de plus en plus à géométrie variable.
Une telle structuration des partis politiques n’est pas en soi antinomique avec la mise sur pied d’un parti apte à conquérir le trophée suprême. Qui ne voit pourtant qu’elle ne menace pas parfois cette capacité. La connexion entre le résultat des élections nationales et des élections locales (Parodi, 1983: 42-72), qui servent de plus en plus à sanctionner le gouvernement en place, explique le peu d’entrain que certains élus manifestent pour s’engager dans une campagne présidentielle. Ce fut notamment le cas en 2007 au PS. La conquête de vingt régions métropolitaines sur vingt-deux en 2004, ainsi que de nombreuses présidences de conseil général, ont conduit de nombreux notables du parti à s’engager d’autant plus mollement dans la campagne que la conjoncture économique leur apparaissait particulièrement peu propice à une politique généreuse. À l’inverse, leur entrain à soutenir François Hollande en 2012 n’aurait peutêtre pas été aussi important s’il ne s’était pas agi aussi par ce biais d’empêcher la mise en œuvre de la réforme territoriale voulue par Nicolas Sarkozy qui aboutissait à réduire drastiquement le nombre de conseillers territoriaux. Dans les deux cas, l’on ne saurait non plus oublier combien la stratégie politique du candidat à l’élection présidentielle reste étroitement bornée par la prégnance des considérations partisanes locales. Le refus de Ségolène Royal en 2007 de proposer une alliance au candidat centriste François Bayrou avant le second tour de l’élection présidentielle ou celle de François Hollande d’intégrer ce même leader dans la majorité sont incompréhensibles si l’on ne prend pas en compte le refus d’une écrasante majorité d’élus du PS et de ses militants de remettre en cause les alliances politiques locales sur lesquelles reposent leur domination.
La droite fait-elle exception ? A la différence de la gauche, elle a perdu entre 2002 et 2008, de très nombreuses élections locales. Cette situation a favorisé la conquête de l’UMP par Nicolas Sarkozy en 2004 et sa capacité à la transformer en machine présidentielle. En effet les barons locaux du parti (présidents de conseils généraux et régionaux, maires de grandes villes) étaient largement affaiblis et n’étaient pas en mesure de s’opposer à la fois à l’orientation très droitière de Nicolas Sarkozy et à sa politique de renouvellement des cadres du mouvement. Une fois élu président de la République, celui-ci va payer cher les défaites successives aux élections locales et régionales, notamment en 2010 lorsque la droite perd le contrôle de la chambre haute (le Sénat) au profit de la gauche, un fait sans précédent depuis que le Sénat existe sous cette forme en 1875. En France en effet, les sénateurs sont élus au second degré par les élus locaux. Du fait de ce mode d’élection, les élus ruraux sont surreprésentés au Sénat et nombre d’entre eux sont très indépendants à l’égard des partis politiques. Mécontents à l’égard du président Sarkozy, élu de la région parisienne, à qui il reproche d’avoir négligé les campagnes en fermant de nombreux services publics, de nombreux sénateurs prennent alors leurs distances avec l’UMP., Cette logique d’autonomisation ne peut se comprendre si l'on ne met pas au coeur de l'analyse l'enjeu que constitue la défense de positions locales.
Beaucoup considéreront sans doute que les analyses qui précèdent ne mettent pas en cause la tendance lourde à la présidentialisation des partis politiques qui se manifeste principalement par la personnalisation de la compétition partisane, dont un des indices le plus manifeste serait le changement dans le mode de désignation des chefs des partis de gouvernement et des candidats à l’élection présidentielle. Là encore pourtant cette tendance se heurte à de nombreux obstacles.
L'adaptation partisane à la présidentialisation des institutions : un jeu plus
complexe qu'il n'y paraît
Loin de l'idée originelle selon laquelle l'élection présidentielle au suffrage universel direct aurait inéluctablement conduit à l'affaiblissement des partis politiques français, nombreux sont ceux qui soulignent désormais l'idée que les partis, en s'adaptant à la centralité de l'institution présidentielle, se sont finalement renforcés au sens où ils apparaissent aujourd’hui indispensables pour qui veut arracher le trophée présidentiel. Gérard Grunberg ou Christine Pütz considèrent ainsi que les partis exercent, à rebours du souhait du Général de Gaulle, “une influence centrale sur la désignation de l’exécutif, les candidatures à la présidentielle [étant] fondamentalement partisanes et liées à la direction du parti” (Pütz, 2007: 324 ; Grunberg, 2006: 451-476). La notion d'adaptation suppose à la fois que les partis aient adopté un mode de désignation de plus en plus ajusté aux contraintes supposées de l'élection présidentielle et que le cœur de leur fonctionnement interne soit structuré par l'échéance présidentielle. Cette notion d'adaptation partisane est cependant rarement directement interrogée et se trouve donc souvent envisagée de manière trop déterministe, automatique et simpliste. Le jeu apparaît bien plus ouvert et complexe si l'on considère en particulier la durée du processus et les dynamiques – bien plus horizontales que verticales – qui le soustendent. La désignation partisane du candidat présidentiel s'apparente à un processus lent paradoxal et indirect.
Premier constat, si l’adaptation a eu lieu, elle a mis du temps. Entre la révision constitutionnelle de 1962 et l'introduction par le PS d'un vote de désignation du candidat socialiste par les adhérents en 1995 ou la première mise en œuvre par le même parti de « primaires ouvertes » pour 2012, respectivement trente-trois et cinquante années se sont passées. Autant dire que l'adaptation n'a rien eu de spontané ni d'automatique. Second constat, c’est paradoxalement le parti qui était à l'origine le plus réticent à l'égard du renforcement de l’institution présidentielle, qui a été précurseur dans ce processus d'adaptation. Le PS a d'abord plus rapidement que la droite gaulliste et néogaulliste réussi à n'avoir qu'un seul candidat issu de ses rangs. Il a ensuite été le premier à adopter puis à modifier des règles de désignation de son candidat en passant de ce que l'on a coutume d'appeler de “primaires fermées” (destinées exclusivement aux adhérents) dès 1995, à des primaires “semi-ouvertes” pour les élections de 2007 (ici, la désignation était toujours entre les mains des adhérents mais la campagne préalable d'adhésion à vingt euros a élargi considérablement – quoique momentanément – leur nombre), à des “primaires ouvertes” incluant les sympathisants. En ouvrant progressivement et le plus largement possible les cercles de ceux qui vont désigner le candidat présidentiel du parti, le PS s'inscrit bien dans une logique d'ajustement aux contraintes du marché électoral présidentiel puisqu'il s'agit d'approcher au maximum le contour des futurs électeurs. Toutefois, Rémi Lefèbvre (2011) a bien montré que les primaires se sont imposées dans le parti, contre le souhait de la plupart de ses leaders, comme une solution visant à permettre à la première secrétaire élue d’extrême justesse dans des conditions jugées par beaucoup frauduleuses, de disposer d’une majorité durable. Jusqu’au retrait contraint de la compétition de Dominique Strauss-Kahn, beaucoup de responsables du parti avaient en outre l’espoir que cette primaire ne constituerait qu’une procédure de ratification.
S’il est indéniable que le mode de désignation des instances dirigeantes du parti à la proportionnelle comportait de hauts risques de tension avec la contrainte présidentielle qui pousse un parti de gouvernement à disposer d’un leader incontesté, il convient de rappeler que les dirigeants du PS ont recouru en 1995 à une autre solution que les élections primaires pour réduire cette tension : l’élection du premier secrétaire au suffrage direct des adhérents. Conçue comme un moyen de conférer au premier secrétaire une légitimité difficilement attaquable et le situer au-dessus des courants, ce dispositif n’a pas été suffisant pour en 2007. Le premier secrétaire de l’époque, François Hollande, apparaissait en effet très affaibli après les déchirements du parti lors du référendum interne sur le Traité constitutionnel europée. Pour éviter la scission du parti, il a dû alors accepter de sortir du jeu, contribuant ainsi à une situation de crise ayant débouché sur la recherche d’une nouvelle procédure de désignation du candidat du parti puis sur l’émergence d’un leader largement extérieur au jeu des courants: Ségolène Royal.
La droite partisane, le RPR puis l'UMP, a toujours été à la traîne par rapport au PS alors même que son soutien au renforcement de l'institution présidentielle était acquis. C'est l'autre face du paradoxe. Ainsi, l’élection directe du leader du parti par les adhérents est introduite plus de cinq ans après le PS en 1998, la désignation du candidat présidentiel par ces mêmes adhérents est mise en œuvre douze ans après le PS, en 2007, mais sans réelle compétition interne, puisque seul Nicolas Sarkozy se présente aux suffrages des adhérents! En 2012, il n’y a pas eu de vote et l’annonce de candidature de Nicolas Sarkozy a été faite par une déclaration télévisée.
Le décalage entre le PS et l'UMP souligne les résistances du parti de droite non pas par méfiance à l’égard de la logique présidentielle et de la personnalisation qu’elle génère mais en raison de ses réserves à l’égard de la “partisanisation” du combat présidentiel et des traces de son attachement à forme d’onction présidentielle suprapartisane. On peut en tenir pour preuve le “non dit” statutaire qui a caractérisé l'UMP s’agissant du mode de sélection du candidat à l’élection présidentielle. Au moment de la création de l’UMP, en 2002, les nouveaux statuts ne règlent pas cette question, préférant l’éluder plutôt que d’ouvrir la boîte de Pandore. En décembre 2005, alors que Nicolas Sarkozy a conquis la présidence de l’UMP depuis un an, une étape est franchie par l’inscription des règles de sélection d’un candidat présidentiel dans les statuts. Ce texte précise que le candidat présidentiel doit être “soutenu” et non “investi” par le parti (l’investiture partisane proprement dite étant en contradiction avec la tradition gaullienne). La procédure est longtemps restée floue et non contraignante. La dernière étape – l’élargissement du mode de désignation du candidat présidentiel – a été franchie par l'UMP en 2012 dans un contexte de guerre de succession ouverte pour la présidence du parti qui entraîne de très nombreux litiges. Les statuts sont alors révisés et la procédure de sélection du candidat présidentiel est codifiée dans une “Chartre des primaires” qui met en place une procédure des “primaires ouvertes” auxquelles peuvent s’inscrire les citoyens “adhérents aux valeurs de la République et reconnaissant dans les valeurs de l’Union” (article 1) et auxquelles doivent se soumettre tous les candidats voulant bénéficier du soutien du parti. Elle prévoit également la mise en place d'une “Haute Autorité des Primaires” composée de quatre membres extérieurs à l’UMP dotés de compétences juridiques et de représentants désignés par les candidats mais n’ayant pas voix délibérative (article 7). A l'instar du PS, l'adoption des primaires par l'UMP s'inscrit dans une logique de réponse à une grave crise interne. La codification de la procédure des primaires n'aurait peut-être pas eu lieu sans la profonde déstabilisation du parti de 2012.
Cette rapide analyse de la manière dont le PS et l'UMP ont fait évoluer les règles de désignation de leur candidat à l'élection présidentielle indique qu'on ne peut considérer ce processus comme un mouvement d'imposition par le haut ou par l'extérieur d’une contrainte institutionnelle. Les relations horizontales, celles forgées par la compétition inter-partisane, sont de ce point de vue déterminantes de même que les enjeux internes, en particulier dans les situations de crise organisationnelle. On notera enfin que les modifications relèvent pour beaucoup d'une forme de mimétisme entre partis : l'UMP suivant, de manière décalée, les changements introduits par le PS. Cette adaptation relève largement du cas désigné comme “l'isomorphisme mimétique” (Di Maggio et Powell, 1983: 147-160), situation où l'incertitude conduit à l'imitation. Adopter ce cadre d'analyse permet alors de remettre au cœur de l'interprétation les organisations partisanes et leur système de relation.
En guise de conclusion : Les partis comme acteurs des changements institutionnels
La non prise en compte des partis dans toute leur complexité interroge au final les fondements du déterminisme institutionnel. Nous avons voulu suggérer ici qu’il n’est pas sûr que l’opposition entre stratégies, contraintes et ressources institutionnelles soit la meilleure façon de rendre compte de l’interaction entre les partis et les institutions. Entre d'un côté, une représentation où les partis s'adaptent à des règles institutionnelles s'imposant à eux de l'extérieur et, de l'autre, une conception postulant la cohérence de leurs visée et projets institutionnels, nous avons vu que les contraintes institutionnelles se superposaient, qu'elles pesaient et étaient perçues différemment selon les acteurs partisans et les conjonctures, que la notion d'imitation avait souvent plus de pouvoir explicatif que l'adaptation. Ainsi, les intérêts composites dont doivent tenir compte les dirigeants des partis, les situations d'incertitude et de déstabilisation interne conduisent le plus souvent à bricoler des solutions institutionnelles dans l’urgence sans toujours mesurer les effets des décisions prises
Références Bibliographiques:
Behr, Valentin y Michon, Sébastien. (2013). The Representativeness of French Cabinet
Members in the Fifth Republic: a Smokescreen? French Politics, Vol. 12, n°4, pp. 332-
355.
Di Maggio, Paul J. y Powell, Walter W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American
Sociological Review, Vol. 48, n°2, pp. 147-160.
Duverger, Maurice. (1951). Les partis politiques, Paris: Armand Colin.
Eldersveld, Samuel J. (1964). Political parties: a Behavioral Analysis. Chicago: Rand
McNally.
Epstein, Leon. (1986). Political Parties in the American Mold. Madison: The University
of Wisconsin Press.
François, Bastien. (1999). Le régime politique de la Ve République, Paris: La
Découverte.
Gaïti, Brigitte. (1985). « Politique d’abord »: le chemin de la réussite ministérielle dans
la France contemporaine. En: Birnbaum Pierre (dir.) Les élites socialistes au pouvoir.
Les dirigeants socialistes face à l’Etat (pp. 53-85). Paris, Presses universitaires de
France.
Gaxie, Daniel. (1986). Immuables et changeants : les ministres de la Vème République.
Pouvoirs, Vol. 36, pp. 61-78.
Grunberg, Gérard. (2006). L’adaptation du système des partis (1965-2006). En:
Culpepper, Pepper D., Hall, Peter A. y Palier, Bruno (dir.). La France en mutation.
1980-2005 (pp. 451-476). Paris: Presses de Sciences Po.
Haegel, Florence. (2012). Droites en fusion. Transformations de l’UMP. Paris: Presses
de Sciences Po.
Kirchheimer, Otto. (1966). The Transformation of the Western European Party
Systems. En: La Palombara, Joseph y Weiner, Myron, (eds), Political Parties and
Political Development (pp. 177-200). Princeton (N.J.): Princeton University Press.
Lagroye, Jacques, François, Bastien y Sawicki, Frédéric. (2012). Sociologie politique.
Paris: Dalloz y Presses de Sciences Po.
Lefebvre, Rémi y Sawicki, Frédéric. (2006). La société des socialistes. Le PS
aujourd’hui. Bellecombe-en-Bauges: Éditions du Croquant.
Lefebvre, Rémi. (2011). Les primaires socialistes. La fin du parti de militants? Paris:
Raisons d’agir.
Mischi, Julian. (2014). Le Communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires
depuis les années 1970. Marseille: Agone.
Parodi, Jean-Luc. (1984). Imprévisible ou inéluctable, l'évolution de la Cinquième
République. Éléments constitutifs et combinatoires institutionnelles. Revue française de
science politique. Vol. 34, n°4-5, pp. 628-647.
Parodi, Jean-Luc. (1983), Dans la logique des élections intermédiaires, Revue politique
et parlementaire, 903, 1983, pp. 42-72
Portelli, Hugues. (1980). La présidentialisation des partis français. Pouvoirs, Vol. 14,
pp. 97-106.
Pütz, Christine. (2007). La présidentialisation des partis français. En: Haegel, Florence
(dir.). Partis et système partisan en France (pp. 321-357). Paris: Presses de Sciences
Po.
Wattenberg, Martin P. (1991). The Rise of Candidate Centered Politics. Cambridge
(Mass.): Harvard University Press.
⌘
Frédéric Sawicki est Professeur de science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Directeur de l'URPRESA CRAPS (1999-2001) puis de l'UMR CERAPS (2002-2009), Professeur agrégé de science politique à l'Université Lille 2 (1995-2009), membre du conseil scientifique de l'Université Lille 2 (2005-2009), membre du comité éditorial de la Revue Politix-Sciences sociales du politique (depuis 1988), membre du jury du concours national d'agrégation externe de science politique (2008-2009), membre du comité sectoriel SHS de l'Agence nationale de la recherche (2007-2008). Vice-président du comité de programme "Gouverner-administrer" de l'ANR (2008-2011). Ouvrages : 1. Le pouvoir. Science politique, sociologie, histoire, (1994, réédition 1999); Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, (1997) Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines, (1998) (en co-direction avec Jean-Louis Briquet);; L’implantation du socialisme en France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation (2001) (en collaboration avec Jacques Girault, Jean-William Dereymez, Frank Georgi, Denis Lefebvre, Danielle Tartakowsky); Mobilisations électorales. Le cas des élections municipales de 2001, (2005) (sous la direction de Jacques Lagroye, avec Bastien François); La société des socialistes. Le PS aujourd’hui, (2006) (avec Rémi Lefebvre). Il a beaucoup contributions à des ouvrages collectifs.
Florence Haegel est Directrice de recherche, professeure d´Centre d´études européenes de Sciences Po. Co-responsable du master “sociologie politique comparée” au sien du parcours doctoral en science politique à l’Ecole doctorale de Sciences Po. Membre du comité de rédaction de la revue Sociétés contemporaines. Ouvrages: Les droites en fusion. Transformation de l'UMP. (2012); Destins ordinaires. Identité singulière et mémoire partagée. (2010) (avec Marie-Claire Lavabre) ; La France, vers le bipartisme ? La présidentialisation du PS et de l’UMP. Nouveaux Débats. (avec Grunberg, Gérard); Dictionnaire de la droite. (2007) (avec Jardin, Xavier, Frédéric Fogacci, Nicolas Sauger); L’Enquête et ses méthodes: l’entretien collectif (2004) (avec Duchesne, Sophie).
Pasado Abierto, Facultad de Humanidades, UNMDP se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
[1]Pour une définition et discussion précise de cette notion, cf. Lagroye, Jacques; François, Bastien et Sawicki, Frédéric (2012: 168 et ss).
[2]Samuel Eldersveld qualifie les partis américains de “stratarchies”. Eldersveld (1964), également Epstein (1986).
[3]Cette différence entre partis anglais et américains a bien été pointé par Duverger, (1951: 431 et ss)
[4]Au cours du XXe siècle, la France a connu quatre régimes constitutionnels (trois “Républiques”, un régime autoritaire pendant l’occupation allemande de 1940 à 1944), et six au cours du XIXe siècle.
[5]Pour une analyse claire de la nature du régime et de son évolution depuis 1958, on se reportera à Bastien, 1999.
[6] L’élection du président au suffrage universel n’est pas en elle-même la raison qui explique les pouvoirs très importants que se sont progressivement attribués les présidents de la République française. L’omnipotence présidentielle tient d’abord aux conditions dans lesquelles le général de Gaulle a été amené à occuper le premier ce rôle. Leader charismatique, revenu au pouvoir comme un sauveur, il a pu d’autant plus facilement concentrer de nombreux pouvoirs que la France était en situation de guerre en Algérie. Mais l’omnipotence présidentielle a également été favorisée par la bipolarisation de la politique découlant du scrutin majoritaire à deux tours adopté pour l’élection des députés à partir de 1958, alors que depuis 1945 ceux-ci étaient élus au scrutin proportionnel.
[7]Cf. par exemple Parodi, (1984: 628-647); Portelli, (1980: 97-106) et Portelli, (2008: 61-70)
[8] A la différence de l’Argentine, l’initiative d’organiser des primaires ouvertes est venue des partis politiques et n’a en aucune façon fait l’objet d’une loi. Elle n’est en rien une obligation légale. Les autres partis politiques français continuent largement de recourir aux votes de leurs adhérents pour choisir leur candidat à l’élection présidentielle.
[9]En 2015, l’UMP a été rebaptisée Les Républicains.
[10]Il est élu avec près de 80% des voix face au candidat de l’extrême-droite Jean-Marie Le Pen, après qu’à la surprise générale, le candidat socialiste, premier ministre en poste, Lionel Jospin, a été éliminé au premier tour. En France, l’élection présidentielle se déroule à deux tours: seuls les deux candidats arrivés en tête du premier tour peuvent se présenter au second tour.
[11]On trouvera de nombreux exemples de dissidences locales dans Mischi, (2014).
[12]Sur le PS, cf. Lefebvre et Sawicki, (2006).
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2015 Pasado Abierto

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
.jpg) |
ISSN 2451-6961 (online) Open Past is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |
| Included in: | |
| ROAD https://portal.issn.org/resource/ISSN/2451-6961 |
| LatinREV https://latinrev.flacso.org.ar/mapa |
| Latindex Directory https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=26011 |
| Google Scholar Link |
| BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Link |
 | Latin American (Association of Academic Journals of Humanities and Social Sciences) Link |
 | MIAR (Information Matrix for Journal Analysis) Link |
 | SUNCAT Link |
 | WorldDCat Link |
 | Ibero-American News Link |
| CZ3 Electronische Zeitschriftenbibliothek Link |
| Open Science Directory Link |
| EC3 metrics Link |
| JournalsTOCs Link |
| Malena Link |
| Evaluated by: | |
 | Latindex Catalog 2.0 Link |
 | Basic Core of Argentine Scientific Journals Link |
 | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link |
 | ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) Link |
 | REDIB (Ibero-American Network of Innovation and Scientific Knowledge) Link |
 | CIRC (Integrated Classification of Scientific Journals) Link |
| Open Past uses the persistent identifier: | |
|









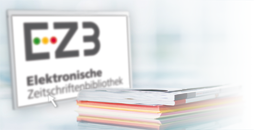




.png)